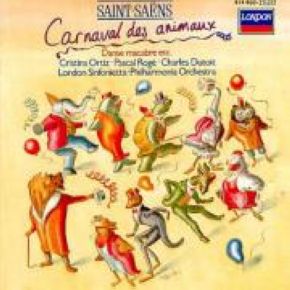Exposition "Musicanimale : le grand bestiaire sonore" à la Philharmonie Les oiseaux en musique
Oiseaux et coquillages, papier peint 1805, Ville de Paris / Bibliothèque Forney
A l'occasion de l'exposition "Musicanimale : le grand bestiaire sonore" à la Philharmonie de Paris (20 septembre - 23 janvier 2023), retour en musique sur le chant des oiseaux à travers les époques.
Depuis plus d’un siècle, la bioacoustique, science de la communication sonore animale, est à l'écoute de la nature. Parmi toutes les espèces étudiées, cette discipline s’intéresse aux sons émis par les oiseaux, qui, par leurs variétés et leurs aspects enchanteurs, ont toujours émerveillé l’esprit humain. L’un de ses grands fondateurs, Bernie Krause, apôtre de l’écologie du paysage sonore, tente de nous sensibiliser à la disparition de nombreuses espèces. En effet, en ces temps de grands bouleversements écologiques, cette science observe nombre de conséquences sur les volatiles, animaux fragiles et vulnérables. On ne soulignera jamais assez l’impact de l’activité humaine sur l’extinction de certaines de ces espèces, dont le chant s’éteint à mesure que l’activité humaine progresse.
L’art, de son côté, n’a pas été en reste. La musique a toujours été fascinée par les chants et les sons produits par les oiseaux. Elle a véritablement su se les approprier et, d’une certaine manière, les conserver. Dès le Moyen-Âge, en effet, les compositeurs ont puisé leurs inspirations dans les sons des volatiles les plus divers, à la fois modèles et rivaux. Ils ont cherché à en rendre compte de différentes manières. C’est ce que nous nous proposons d’étudier maintenant.
Évoquer les oiseaux sans imiter leurs chants
Dans notre recensement, la première manière de mettre en scène les oiseaux dans la musique est la plus lointaine et la moins directe. C’est également la moins évidente à l’oreille. Il ne s’agit pas d’une imitation d’un chant à proprement parler mais d’une évocation plus globale du volatile. Elle passe par la création d’une atmosphère générale ou par la caractérisation d’un élément de l’anatomie ou du comportement de l’oiseau. L’exemple le plus célèbre en est sans nul doute Le Cygne de Camille Saint-Saëns extrait de la suite du Carnaval des animaux. La partie de ce morceau jouée au piano symbolise l’eau alors que l’oiseau est rendu par le violoncelle dont la technique du legato caractérise à merveille la façon avec laquelle l’animal évolue majestueusement sur l’eau.
Un autre exemple musical éloquent s’intéresse à la Corneille. Il est tiré du lied Die Krähe, pièce du célèbre cycle de Franz Schubert Le Voyage d’Hiver, composé sur des poèmes de Wilhelm Müller. L’oiseau y est symbolisé par la main droite du pianiste accompagnateur qui imite les cercles concentriques décrits par le volatile autour du vagabond.
L’évocation du monde des oiseaux peut également se faire plus diffuse et plus complexe dans une œuvre musicale. Le meilleur exemple peut en être la pièce pour clavecin de Rameau : Le Rappel des oiseaux. Elle est extraite de la première suite datée de 1724. Cette fois c’est par différents procédés qu’est rendue l’agitation continuelle des animaux (répétition obstinée de rythmes, phrases très rapides que le compositeur a appelées des roulements, polyphonie à trois voix, chromatismes et intervalles dissonants). Ce type de pièce qui ne porte pas un nom de danse au sein d’une suite (gavotte, menuet, sarabande…) est appelé « pièce de genre ».
Imiter les chants d’oiseaux
La présence des oiseaux dans la musique est également celle de leur chant lui-même, imité par les compositeurs dans leurs œuvres.
Une des premières pièces qui emprunte à cette technique se rencontre à la Renaissance. Il s’agit de la polyphonie profane de Clément Janequin intitulée Le chant des oiseaux. Le compositeur a recours à la fin de la pièce à des onomatopées qui sont directement interprétées par les différentes voix des chanteurs et qui imitent les chants du sansonnet, du rossignol ou encore du coq.
Plus généralement, les compositeurs usent des bois de l’orchestre pour imiter les oiseaux. La coda du second mouvement de la Symphonie pastorale de Ludwig van Beethoven met par exemple en scène différents chants d’oiseaux. La flûte imite le rossignol, auquel répondent la clarinette dans le rôle du coucou et le hautbois dans celui de la caille. Le maître de Bonn a lui-même inscrit ces trois noms d’oiseaux sur sa partition.
Transcrire les chants d’oiseaux : Olivier Messiaen
« Écoutez les oiseaux, ce sont de grands maîtres ! »
« La musique, en son double aspect de message, de communication et de silence, de joie artistique, est certainement sortie du chant des oiseaux… »
Olivier Messiaen
Faisant écho à cette réflexion que lui fit un jour son professeur Paul Dukas, Olivier Messiaen semble naturellement se définir : compositeur, ornithologue, professeur…
« L’Abîme c’est le Temps, avec ses tristesses, ses lassitudes. Les oiseaux, c’est le contraire du Temps ; c’est notre désir de lumière, d’étoiles, d’arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises »
Messiaen (préface de la partition)
Né en 1908 à Avignon, Olivier Messiaen, après de brillantes études au Conservatoire de Paris, est nommé en 1930 titulaire des grandes Orgues de la Trinité, tribune qu’il tiendra pendant 30 ans, sauf pendant la Seconde guerre mondiale, où il est fait prisonnier par les allemands et déporté au camp de Görlitz en Silésie. C’est durant sa captivité qu’il compose l’un de ses chefs d’oeuvre : Le Quatuor pour la fin du temps, qui trouve sa source dans une citation du chapitre X de l’Apocalypse de Saint Jean. Cette œuvre représente également la première manifestation de chants d’oiseaux (notamment dans le 3ème mouvement, « Abîme des oiseaux »).
Messiaen est le premier compositeur à avoir pleinement saisi les difficultés que pose la fidélité à la nature dans l’acte de transcription, et le premier à avoir travaillé sur des notations de chants vraiment scientifiques, proches de l’exactitude. Voici un lien vers les chants d’oiseaux originels suivis du chant retranscrit pour le piano : loriot d’Europe, rougequeue, troglodyte mignon, rouge-gorge, merle noir, grive musicienne, fauvette des jardins et pouillot véloce sont ainsi écoutés, notés sur partition et joués au piano.
Outre la composition et l’enseignement, Messiaen se concentre sur la recherche des vérités divines, l’amour du son-couleur, la métrique grecque, et bien sûr la prospection ornithologique.
Son magnifique Catalogue d’oiseaux dédié à Yvonne Loriod est composé entre 1956 et 1958, œuvre pour piano de treize pièces, dont chacune porte le nom d’un oiseau. Olivier Messiaen cherche ainsi « à rendre avec exactitude le chant de l’oiseau type d’une région, entouré de ses voisins d’habitat, ainsi que les manifestations du chant aux différentes heures du jour et de la nuit ».
« Entre 3 et 4 heures du matin, le réveil des oiseaux ; un merle, ou un rossignol soliste, improvise, entouré de poussières sonores, d’un halo de trilles perdus très haut dans les arbres. Transposez sur le plan religieux : vous aurez le silence harmonieux du ciel … »
Messiaen, à propos de la Liturgie de cristal
On peut également citer dans l’œuvre de Messiaen des pièces comme Le Merle Noir, Le Réveil des Oiseaux, certains passages des Visions de l’Amen, de Saint François d’Assise ou encore ses Oiseaux Exotiques, une œuvre dans laquelle un piano et un petit orchestre interprètent quarante-six espèces d’oiseaux du monde entier !
Intégrer la nature à la composition
Le 1er enregistrement connu de chant d’oiseau date de 1889 : il est attribué à Ludwig Karl Koch, qui capte le son d’un oiseau Shama en captivité dans un zoo allemand. Il sera au début des années 30 à l’origine du livre sonore, concept de livre illustré accompagné de disques enregistrés sur phonographe, en quelque sorte l’ancêtre du document multimédia.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’ornithologue américain Arthus Augustus Allen mène avec ses étudiants des études sur les enregistrements des chants d’oiseaux qui aboutiront au 1er enregistrement sur phonographe de chants d’oiseaux en 1932.
Les compositeurs ne tarderont pas à s’emparer de ces nouvelles possibilités qu’offre la technologie. Dès 1924, Ottorino Respighi (1879-1936) utilise des enregistrements de chants d’oiseaux dans le 3ème mouvement de son poème symphonique Les Pins de Rome.
L’invention de la bande magnétique en 1930 permet non seulement d’enregistrer, mais de monter et d’orchestrer des sons enregistrés.
Edgard Varèse (1883-1965) combine des enregistrements de chants d’oiseaux avec de la musique jouée sur scène dès 1954 pour Déserts.
« … les oiseaux rappellent ce qu’on entend dans le Cercle Arctique et dans les marais de Liminka… Les flûtes solo sont progressivement rejointes par les autres instruments à vent et le son des oiseaux… Finalement, les cordes entrent sur une mélodie qui doit figurer une personne marchant librement… »
Rautavaraa
C’est aussi ce que fait Einojuhani Rautavaraa, compositeur finlandais né en 1928, dans son Cantus Arcticus en 1972. Sous-titrée « Concerto pour oiseaux et orchestre », cette œuvre « mixte » fait appel à un matériau sonore préenregistré diffusé sur des hauts parleurs (les chants d’oiseaux, qui apparaissent au bout de 1’06’’) et un orchestre symphonique qui joue en direct.
Depuis, le procédé est devenu presque banal, notamment dans la musique électro-acoustique, comme chez François Bayle (Trois rêves d’oiseaux ) ou chez Bernard Fort, compositeur, audionaturaliste et ornithologue, par exemple dans Le miroir des oiseaux (Composition pour ondes Martenot, thérémine, piano préparé et bande sonore, combinant le rossignol et une composition pour un bol de prière tibétain) :
En poussant à l’extrême ce procédé d’utilisation d’enregistrements de la nature, le compositeur Fernand Deroussen invente le concept d’audionaturalisme, véritable art sonore du monde sauvage. Plus esthétique, contemplative, et moins scientifique que la bioaccoustique, cette discipline cherche à capter avant tout la musicalité de la nature, à travers notamment les interactions sonores entre animaux et éléments naturels tels que le bruit du vent, les sons de la pluie ou des vagues, les chants d’oiseaux, symbolisant le grand orchestre symphonique du vivant.
Au terme de ce voyage ornithologique, et pour aller plus loin dans l’exploration de l’univers sonore animal, il importe de citer l’exposition Musicanimale : Le grand Bestiaire sonore que propose la Philharmonie de Paris du 20 septembre 2022 au 29 janvier 2023 : vocalises d’oiseaux, stridulations d’insectes, hurlements chorals de loups, chants mélodiques de baleines y sont déclinés avec intelligence et facétie. Vous y retrouverez notamment une partition de John Cage - Litany for the whale – issue des collections de la MMP. C’est l’occasion également de s’interroger sur le devenir de la biodiversité et la disparition d’un patrimoine sonore en danger.
Pour aller plus loin
En 2020, la Médiathèque musicale de Paris organisait un cycle "Musique et nature". Dans nos archives, retrouvez notamment l'interview avec Jean Roché, effectuée à cette occasion. A découvrir un mix des collections de la médiathèque.
Philharmonie à la demande - Musique et nature (philharmoniedeparis.fr)
92_Les_Oiseaux_dans_la_Musique-cours.pdf (utt-montpellier.fr)
https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/2020/01/17/musique-et-nature-autour-de-lexposition/
Les oiseaux en musique | musiqueauchateau (pascaldubois68.wixsite.com)
Le Chant des oiseaux : un modèle et un défi pour les compositeurs :
https://lentre-deux.com/index.php?b=37
Par Matthieu L., bibliothèque Andrée Chedid, et Anne S., médiathèque musicale de Paris
Sélection de documents à emprunter en bibliothèque
Sélection
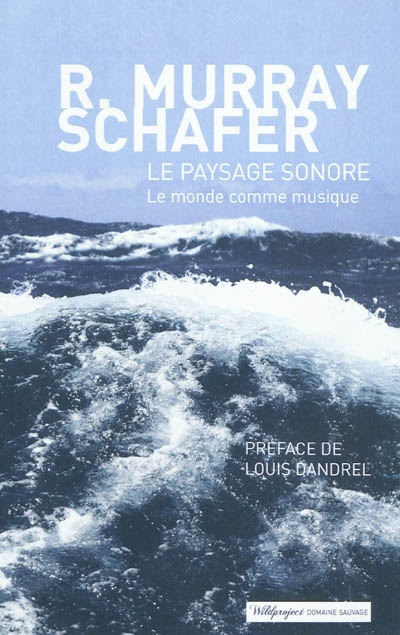
Livre
Le paysage sonore : le monde comme musique
Edité par Éditions Wildproject
Murray Schafer a forgé la notion de paysage sonore pour désigner notre environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu desquels nous vivons. Depuis l’apparition du tout premier bruit – celui de la mer –, le paysage sonore n’a cessé de s’enrichir des sons du monde vivant : oiseaux, insectes, langage, musique… jusqu’à la révolution industrielle et électrique. Terrible et fascinante rupture, qui transforme radicalement notre rapport au son, à la musique – et au silence. Mais qui nous rend aussi désormais capables de mettre en œuvre un authentique design sonore, maîtrisé et conscie...

Partition
Oiseaux exotiques : pour piano solo et petit orchestre : 1955-1956
Edité par Universal Edition
Présentation, nomenclature et emplacement des instruments en français. préfaces trilingues français-allemand-anglais

Musique
Sacred and secular music from six centuries
Edité par Hyperion - 1990
Salve Regina / Hermannus Contractus. Planctus ante nescia / Godefroy de St Victoire. Quant je sui mis / Guillaume de Machaut. Vergene bella ; Gloria ad modem tubae / Guillaume Dufay. Most clear of colour / Robert Fayrfax. O nata lux / Thomas Tallis. Ne irascaris Domine ; Civitas sancti tui / William Byrd. Dezi, flor resplandeciente ; Nuevas, nuevas, Por tu fe ! / Anonymes. Sancta Mater / Francisco de Penalosa. El Jubilate / Mateo Flecha. Tota pulcra es / Heintrich Isaac. Bonjour mon coeur / Claude Goudimel. Le Chant des oiseaux / Clément Janequin.

Musique
Quatuor pour la fin du temps
Edité par [Universal licensing music] ; [distrib., Universal licensing music] - 2002 [D.L.]

Musique
Intégrale des oeuvres pour clavecin. 1
Edité par Stil - 1988
Pièces de clavecin (1724) : Suite en mi mineur : Allemande ; Courante ; Gigue en rondeau ; 2e Gigue en rondeau ; Le rappel des oiseaux ; 1er et 2e Rigaudon et double ; Musette en rondeau ; Tambourin ; La Villageoise. Suite en ré majeur : Les tendres plaintes ; Les niais de Sologne avec doubles.

Musique
Angel of light
Edité par Grammofon Ab Bis - 1999
Symphonie No7 "Angel of light". Danses avec les vents op63, pour flute et orchestre. Cantus Articus op61, "concerto pour oiseaux et orchestre".
![Le grand orchestre des animaux : [exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2 juillet 2016-8 janvier 2017] |](https://covers.syracuse.cloud/Cover/VPCO/MONO/httE4c-bC9oQvWETRrxlfQ2/9782869251212/LARGE?fallback=https%3a%2f%2fbibliotheques.paris.fr%2fui%2fskins%2fdefault%2fportal%2ffront%2fimages%2fGeneral%2fDocType%2fMONO_LARGE.png)
Livre
Le grand orchestre des animaux : [exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2 juillet 2016-8 janvier 2017]
Edité par Fondation Cartier pour l'art contemporain - cop. 2016
Catalogue de l'exposition conçue à partir du travail de Bernie Krause, bioacousticien, scientifique et musicien américain, ayant collecté plus de 5.000 heures d'enregistrements de vocalisations animales dans tous les habitats sauvages menacés par l'activité humaine. Une exploration esthétique, scientifique et philosophique du monde animal. ©Electre 2016

Livre
Chansons animales et cacophonie humaine : manifeste pour la sauvegarde des paysages sonores naturels
Edité par Actes Sud ; Fondation Cartier pour l'art contemporain - DL 2016
Le bioacousticien, qui depuis 1968 a collecté des sons dans plus de 2.000 écosystèmes à travers le monde, expose les enjeux de l'étude des paysages sonores naturels. Il démontre leur place dans la formation des cultures, présente les techniques d'étude qui leurs sont applicables, les champs du savoir concernés par leur étude, etc. Avec des QR codes pour accéder à des échantillons sonores. ©Electre 2016

Musique
The complete Véga recordings 1956-1963
Edité par Decca Records - 2019
Afin de marquer le 95ème anniversaire de sa naissance, Decca Records France présente pour la première fois l'intégrale des enregistrements d'Yvonne Loriod pour le label Véga, réalisés entre 1956 et 1963 en un coffret de 13 CD, dont nombreux sont inédits.
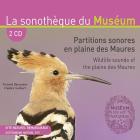
Musique
Partitions sonores en plaine des maures
Edité par Chiff-chaff - 2019
Coffret 2 CD + livret 28 pages bilingue. Ce nouvel opus inaugure la collection «Sites Naturels Remarquables» qui a pour objet la mise en valeur auprès du plus grand nombre du patrimoine naturel sonore français.Edité sous l égide du Muséum national d histoire naturelle, ce coffret tout public témoigne de l exceptionnelle biodiversité de la plaine des Maures, première réserve naturelle nationale du Var. Durant toute une année, l audio-naturaliste Fernand Deroussen a parcouru ce territoire unique en France pour en réaliser l inventaire sonore. Il a également enregistré de magnifiques ambiances na...
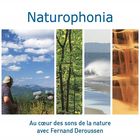
Musique
Naturophonia : Au coeur des sons de la nature avec Fernand Deroussen
Edité par Chiff-chaff - P 2020
Fernand Deroussen aime à dire que notre Terre est une planète qui chante et enchante. Fruit d'un long travail artistique et naturaliste, les 5 créations sonores inédites qu'il a réunies dans cet album nous invitent à la contemplation du monde sauvage et à la redécouverte de l'incroyable diversité du vivant. Fermons les yeux et laissons-nous doucement emporter dans le flot de ses sons naturels. Créations audio-naturalistes : Fernand Deroussen

Livre audio
Les oiseaux et la musique
Edité par Lugdivine - 2005
Ce thème est traité à travers une introduction portant sur le chant des oiseaux, suivie de commentaires d'oeuvres de musique savante et d'une présentation de pièces de musiques traditionnelles (Roumanie, Australie, Vietnam, Burkina Faso) ainsi que d'applications pratiques. ©Electre 2020

Musique
Silence des hommes : trois mois seul avec les sons de la nature
Edité par Chiff-Chaff - C 2020
SONS DE LA NATURE | 16 mars 2020 : veille du premier jour de confinement. Pressentant une opportunité unique, Fernand Deroussen qui se qualifie lui-même de compositeur audio-naturaliste, dispose autour de sa maison dans la vallée du Maravel en Drôme microphones, magnétophones et autres paraboles de captation sonore, un casque vissé sur les oreilles. Plus aucun bruit d'avion, de tronçonneuse ou de moteur durant ces 3 mois où oiseaux, insectes, grenouilles, loups, renards, sangliers, chevreuils et pluie ont composé la grande symphonie du vivant au cœur du réveil printanier. Un album exceptionnel au son pur rarement égalé.
Par Pascale L., Médiathèque musicale de Paris

Livre
Edgard Varèse
Edité par Bleu nuit éditeur - C 2021
Un portrait du compositeur français né en 1883. Après des études d'ingénieur, il se consacre à la musique en étudiant auprès d'Indy, de Roussel et de Widor. Il s'établit aux Etats-Unis à partir de 1915 et devient un pionnier de la musique électronique. Parmi de nombreux projets inachevés, il laisse une quinzaine d'oeuvres abouties telles que Déserts et Nocturnal. ©Electre 2021